Althusser en conjonctures
- NAJIB BENSBIA
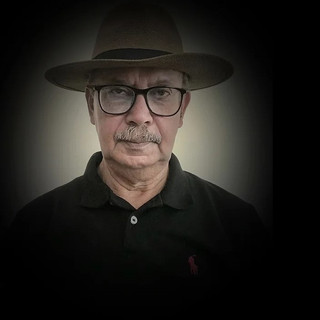
- 5 déc. 2024
- 7 min de lecture
Dernière mise à jour : 6 déc. 2024
Parmi les « maîtres-penseurs » de la seconde moitié du XXe siècle, et les figures marquantes du marxisme critique « occidental », c’est de Louis Althusser l’image qui a le plus changé pendant les années qui nous séparent de sa mort.

Louis Althusser
Par Andrea Cavazzini et Fabrizio Carlino I Cahiers du GRM
Première partie
Incarnation dans les années Soixante d’un marxisme qui a été qualifié de « blindé »1, scientifique et apodictique, fondé sur une lecture originale du texte marxien, Althusser traverse les années 1970 emmuré dans une rareté étrange de la parole, rompue uniquement à l’occasion d’interventions autocritiques destinées à rester énigmatiques2, avant que son parcours public se brise en 1980, suite au drame bien connu, que précède une présence publique retentissante depuis 1978 déclarant la « crise du marxisme » et semblant rompre avec une fidélité auparavant inébranlable au Parti communiste français3. Après, ce sera la publication des autobiographies au début des années 19904, laquelle fera d’Althusser le protagoniste posthume d’un bavardage médiatique souvent indécent, et la construction, à partir de quelques fragments décontextualisés postérieurs à 19805, d’une nouvelle philosophie – le « matérialisme aléatoire » - que le philosophe français n’aurait pu développer convenablement mais qui trouverait sa vérité dans l’appropriation après-coup par la pensée des multitudes que le best-seller Empire va ériger en référentiel central de la théorie sociale et politique pendant toute une séquence de l’histoire intellectuelle.
À partir de 2013, dans le cadre d’un renouveau international de l’intérêt pour les généalogies et les archéologies portant sur la pensée marxiste et l’histoire du communisme, des nombreux inédits sont publiés datant des années 1970, qui documentent – entre autres aspects d’une réflexion complexe, portant notamment sur le statut de la pratique philosophique – un travail intense de confrontation-déconstruction à l’égard de la ligne officielle du PCF et plus généralement du devenir du mouvement communiste international7 – un travail qu’Althusser associe à une activité politique « de fronde » au sein du Parti, animée par plusieurs de ses élèves et collaborateurs, et qui débouche sur les interventions remuantes des années 1978-1980, où la « crise du marxisme » est saluée comme l’ouverture d’horizons politiques inédits pour le mouvement communiste, par-delà sa néfaste fusion avec le référentiel étatique qui gouverne depuis des décennies, et désoriente de plus en plus, ses pratiques et ses stratégies les plus apparemment divergentes, tels le stalinisme et l’« eurocommunisme »8.
Ces publications récentes permettent de rendre plus clair un trajet intellectuel qui s’avère indissociable du destin du communisme en tant que pensée, que perspective politique et que mouvement-monde impliquant des millions d’êtres humains – un trajet dont la disparition de la scène publique ne scelle d’ailleurs pas la fin, mais qui continue à se confronter avec le devenir de la réalité communiste jusqu’à la seconde moitié des années 1980, sous des formes que documentent les textes inédits écrits dans la dernière décennie de la vie du philosophe. Il convient en tout cas de prendre la mesure de l’importance que revêt dans le parcours d’Althusser la conjoncture des années 1970, le travail « clandestin » et « frondiste » au sein du (et contre le) PCF étant la prémisse indispensable des positions sur la « crise du marxisme »9.
Car cette conjoncture est aussi une conjoncture décisive dans l’histoire du mouvement communiste, qu’Althusser, à l’instar de nombreux militants, célèbres ou anonymes, a traversée et vécue (douloureusement) d’une manière qui est indissociablement intellectuelle, politique et biographique. C’est la conjoncture où la Guerre froide passe de l’équilibre des hyperpuissances à la « guerre civile internationale autour du communisme »10 sous l’effet des luttes anti-impérialistes, des conflits sociaux dans les pays du capitalisme avancé et de la division interne du monde communiste à cause du différend sino-soviétique et de la dissidence de gauche en URSS et en Europe de l’Est. C’est cette situation qu’exprime, dans le cadre particulier que représentent les Partis communistes des pays d’Europe occidentale, l’hypothèse « eurocommuniste » élaborée par les Partis italien, français et espagnol, laquelle constitue à la fois la référence polémique constante et le déclencheur conjoncturel immédiat des interventions d’Althusser jusqu’à la fin de la décennie 1970, et vraisemblablement au-delà.
Mais, qu’était-ce que l’« eurocommunisme » ? Comme Althusser l’avait bien saisi, grâce à sa connaissance de l’Italie, cette orientation stratégique – dernier projet international porté par les Partis communistes des pays d’Europe occidentale, avant qu’ils ne se transforment en acteurs, de plus en plus passifs et marginaux, du jeu électoral dans chaque État-nation – n’est guère compréhensible sans faire référence à la ligne du Parti communiste italien depuis la fin de la guerre mondiale et en particulier à son rôle lors de la « séquence rouge » des années 1960-1970. Si bien que le travail d’Althusser dans cette conjoncture peut aussi être considéré comme une confrontation avec l’expérience italienne, laquelle échappe à toute réduction au seul nom de Gramsci…
Au même moment où Althusser mène sa lutte au sein du PCF, de nombreux observateurs issus de la gauche non-communiste se penchent sur le processus politique italien. En particulier, Henri Weber consacre à l’Italie et à la « branche » italienne de l’eurocommunisme un recueil d’interviews avec les principaux dirigeants du PCI11 :
Depuis près de dix ans, l’Italie est le lieu d’un mouvement social sans égal en Europe, par son contenu et son ampleur. Après la secousse tellurique de 1968-1969 le mouvement des masses n’y a pas subi un reflux relatif, comme en France, mais est allé « crescendo ». Contrairement au Portugal, et aujourd’hui à l’Espagne, la crise du capitalisme n’y affecte pas une société dictatoriale et rétrograde, mais une démocratie bourgeoise représentative d’un pays capitaliste avancé12.
Cette capacité à s’inscrire dans la durée et dans le tissu de la société de la part du mouvement social implique l’essor de formes inédites de mobilisation et de conjonctions entre groupes et revendications différents :
La conjonction de l’explosion étudiante et de la révolte ouvrière – qui fit si gravement défaut au Mai français – démultiplie la puissance du mouvement de masse, en même temps que sa charge subversive : plus de dix millions de salariés participent durablement à la lutte ! Ils ne se battent pas sur des mots d’ordre corporatistes, subordonnés à la logique du système, mais pour des objectifs anticapitalistes, contradictoires à cette logique : la lutte pour l’augmentation des salaires est liée à la lutte pour le resserrement de l’éventail hiérarchique (…), pour l’indépendance des rétributions par rapport à la productivité (…). Cette lutte contre l’organisation capitaliste de la production débouche sur la revendication du contrôle ouvrier sur l’organisation du travail : droit de véto sur l’embauche, les licenciements, l’affectation des postes, la grille des rémunérations, la formation professionnelle, l’implantation d’usines nouvelles, l’investissement (…). Enfin et surtout, la dimension anti-capitaliste du mouvement, la volonté de pouvoir qui l’anime, se vérifient dans l’essor de l’auto-organisation ouvrière, le mouvement des conseils d’usine (…). Le mouvement des délégués de base, à l’origine de la structuration en conseils, s’est développé contre la politique des directions syndicales (…). En témoigne (…) l’influence du mouvement étudiant et de l’extrême-gauche révolutionnaire dans les assemblées (…). Ce mouvement anticapitaliste (et antibureaucratique) des masses ne se limite pas, on le sait, aux murs des usines. Il investit le terrain du cadre de vie et des institutions : mouvement d’auto-réduction du prix des transports, du gaz, de l’électricité, du téléphone, des loyers, des impôts (…) ; lutte contre le phallocratisme et la famille patriarcale, contre l’Ecole, la justice de classe, l’armée13.
Le mouvement de masse qui se développe en Italie après 1968 ne se réduit nullement à une poussée trade-unioniste de défense des intérêts ouvriers (…). Pour parler comme Gramsci, il s’agit d’un mouvement à visée hégémonique (…) : il s’attaque à la logique du système capitaliste plus qu’il n’en procède (…). Sa dynamique (…) est la structuration de la classe ouvrière en contre-pouvoir (…) : pour engendrer une véritable dualité de pouvoir, à la faveur de la première aggravation qualitative de la crise italienne, il ne lui manque que l’action cohérente et résolue d’un « parti des conseils ouvriers »15.
Autrement dit, la séquence rouge italienne est le « laboratoire » où la problématique de la « révolution en Occident » est traitée de la manière la plus intense, et où par conséquent émergent des hypothèses, plus ou moins cohérentes et organiques, concernant la transformation du mouvement communiste international par-delà son indépassable héritage stalinien.
A suivre...
---
Notes :
1 Par exemple par Franco Fortini dans le texte que nous publions en traduction française dans ce Dossier.
2 L. Althusser, Éléments d'autocritique [1972] ; (suivi de) Sur l'évolution du jeune Marx, Paris, Hachette, 1974 ; puis recueilli dans L. Althusser, Solitude de Machiavel et autres textes, Paris, PUF, 1998, pp. 159-180.
3 Mais préparée déjà par quelques interventions publiques entre 1976 et 1977. Voir L. Althusser, 22ème Congrès, Paris, Maspero, 1977 (tiré d’un exposé qu’Althusser donna en Sorbonne en décembre 1976) ; « Enfin la crise du marxisme ! », dans Pouvoir et opposition dans les sociétés contemporaines, Paris, Seuil, 1977, puis recueilli dans Solitude de Machiavel, op. cit., p. 267-280 ; « Le marxisme comme théorie finie » (1978), dans Solitude de Machiavel, op. cit., pp. 281-296 ; Ce qui ne peut plus durer dans le Parti communiste, Paris, Maspero, 1978. Rappelons aussi la conférence de Barcelone, prononcée en juillet 1976 : « Un texte inédit de Louis Althusser – Conférence sur la dictature du prolétariat à Barcelone », in Période http://revueperiode.net/un-texte-inedit-de-louis-althusser-conference-sur-la-dictature-du-proletariat-a-barcelone/
4 L. Althusser, L'avenir dure longtemps ; suivi de Les faits, éd. établie et présentée par Olivier Corpet et Yann Moulier-Boutang, Paris, Stock-IMEC, 1992 (dont il existe plusieurs éditions revues et augmentées). Plus récemment : Des rêves d'angoisse sans fin : récits de rêves : 1941-1967 ; suivi de Un meurtre à deux : 1985, textes choisis et présentés par Olivier Corpet ; avec la collaboration de Yann Moulier Boutang, Paris, Grasset-IMEC, 2015.
5 L. Althusser, Écrits philosophiques et politiques, textes réunis et présentés par F. Matheron, t. 1, Paris, Stock-IMEC, 1994, en particulier la section III intitulée « Louis Althusser après Althusser ».
6 Nous faisons bien sûr référence au texte de Antonio Negri et Michael Hardt, Empire, tr. fr. D.-.A. Canal, Paris, Exils, 2000. Pour l’interprétation négrienne du tournant ontologique d’Althusser, voir surtout T. Negri, « Pour Althusser : notes sur l’évolution de la pensée du dernier Althusser », in Futur Antérieur. Sur Althusser. Passages, décembre 1993 ; mais aussi « Machiavel selon Althusser », in Futur Antérieur. Lire Althusser aujourd’hui, avril 1997. Pour quelques pistes de réflexions sur le (non-)rapport entre les démarches opéraïste et althussérienne, nous renvoyons à Fabrizio Carlino, Andrea Cavazzini, « Althusser et l’opéraïsme. Notes pour l’étude d’une "rencontre manquée" », in Période http://revueperiode.net/althusser-et-loperaisme-notes-pour-letude-dune-rencontre-manquee/
7 L. Althusser, Les vaches noires : interview imaginaire, texte établi et annoté par G.M. Goshgarian, Paris, PUF, 2016 ; Écrits sur l'histoire (1963-1986), texte établi et annoté par G. M. Goshgarian, Paris, PUF, 2018 ; Que faire (1977), texte établi et annoté par G.M. Goshgarian, Paris, PUF, 2018 ; Socialisme idéologique et socialisme scientifique, et autres écrits, texte établi et annoté par G. M. Goshgarian, préface de Fabio Bruschi, Paris, PUF, 2022.
8 En plus des interventions publiques (voir note 3) et les manuscrits édités par Goshgarian (voir note 7), rappelons aussi les écrits posthumes recueillis dans la section II, intitulée « Textes de crises », dans Écrits philosophiques et politiques, op. cit., t. 1, en part. L. Althusser, Marx dans ses limites (1978). Sur les derniers textes publics d’Althusser, cf. A. Cavazzini, Crise du marxisme et critique de l’État. Le dernier combat d’Althusser, Séminaire du GRM, février 2008, https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/112399/1/GRM_1_annee_Cavazzini_Althusser.pdf
9 Sur les enjeux de ce travail, et en général des positions politiques d’Althusser, cf. F. Bruschi, Le matérialisme politique de Louis Althusser, Milan/Paris, Mimesis, 2020.
10 Selon une expression de F. Fortini, « Le féminisme en tant que jeu libérateur » (1975), in Cahiers du GRM, 10, OpenEdition
12 Ibid., p. 9.
13 Ibid., pp. 17-19.
14 Ibid., p. 10.
15 Ibid., p. 20.





Comments