Que devient le travail intellectuel ?
- NAJIB BENSBIA
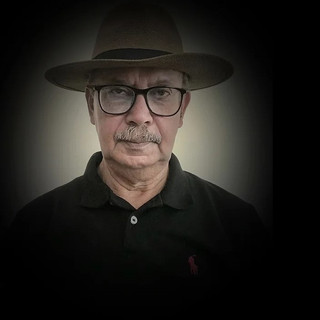
- 5 mars
- 11 min de lecture
La distinction entre ceux qui conçoivent et ceux qui font a implicitement hiérarchisé l’organisation sociale à travers les siècles, conférant une valeur spécifique au travail intellectuel. Mais que valent encore ces hiérarchies dans des sociétés où la majorité des emplois relève du travail intellectuel, où l’intelligence artificielle se développe à grande vitesse et où les libertés de pensée et d’expression sont volontiers contestées ?

Par Anne Dujin I ESPIT
C’est un procès singulier qui a secoué le monde de l’art au printemps 2022, opposant d’un côté le plasticien italien Maurizio Cattelan, rendu célèbre par ses statues provocantes (un enfant agenouillé en prière avec le visage d’Adolf Hitler ou Jean-Paul II frappé par une météorite), et, de l’autre, le sculpteur Daniel Druet, formé aux Beaux-Arts, deux fois lauréat du prix de Rome et sculpteur officiel du musée Grévin1. Le premier, qui revendique volontiers ne rien savoir faire de ses mains, a en effet rémunéré le second pour la réalisation d’un certain nombre de ses pièces. Mais tandis que les œuvres de Maurizio Cattelan atteignaient des prix stratosphériques sur le marché de l’art contemporain, l’exposition d’une copie de la statue d’Adolf Hitler à la Monnaie de Paris en 2016 – réalisée par un autre artiste, sans que le nom de Druet ne soit mentionné – a décidé ce dernier à porter plainte et à revendiquer d’être considéré comme le seul auteur des œuvres. La justice lui a donné tort, considérant que « les directives précises de mise en scène des effigies de cire dans une configuration spécifique » étaient le fait de Maurizio Cattelan, tout comme le « contenu du message éventuel à véhiculer à travers cette mise en scène2 ».
La cosa mentale
L’affaire avait tout pour passionner le milieu de l’art. D’abord par la mise en scène d’un clivage, à la fois éculé et toujours vif, entre les tenants d’un art conceptuel consacré par le marché et ceux de l’art conçu comme un savoir-faire patiemment acquis. Derrière la bipartition de la figure de l’artiste – génial provocateur ou artisan d’exception, les deux évacuant au passage la dimension toujours collective du travail artistique – se logeait surtout la reprise d’un débat vieux de plus de cinq siècles sur le rapport entre l’idée et la main dans l’art, et le primat supposé de la première sur la seconde. C’est dans le Traité de la peinture de Léonard de Vinci que ce primat est formalisé, quoiqu’il fût déjà revendiqué par les peintres florentins de la fin du xive siècle, Giotto, Masaccio ou Uccello, auxquels on doit la révolution de la perspective : « Si tu me dis que les sciences non mécaniques sont mentales, je répondrai que la peinture est mentale […] la peinture est d’abord dans l’esprit de celui qui la conçoit, et ne peut venir à sa perfection sans l’opération manuelle3. » Autrement dit, si l’artiste peut revendiquer un statut comparable à celui du scientifique, plus qu’à celui de l’artisan, c’est que ce dernier travaille avec ses mains, tandis que c’est dans l’esprit que s’élabore le travail du peintre. Un travail qui a certes besoin de l’opération manuelle pour atteindre sa perfection, mais où cette opération n’est qu’un moyen au service d’une fin qui lui préexiste sous la forme de l’idée, ce que l’histoire de l’art a retenu sous le nom de cosa mentale4. De nombreux questionnements esthétiques modernes s’éclairent encore à l’aune de cette rupture, par exemple quand Alberto Giacometti revendique de rompre avec la vision classique, qui ne serait qu’une « reconstitution raisonnée5 » du réel, pour réapprendre à voir. Ou quand le poète et critique d’art Claude Esteban fustigeait le cubisme comme « l’ultime et superbe exaspération de ce culte de la cosa mentale qui […] n’a pas cessé depuis cinq siècles de gouverner l’art des images en Occident6 ».
Mais bien au-delà du domaine de l’art, il semble que nous soyons encore largement héritiers, dans notre conception de l’activité sociale au sens large, non seulement de la distinction entre l’idée et la main, mais surtout du double rapport – de cause à effet et de supériorité – que cette distinction a établi entre ce qui relèverait de la conception et ce qui relèverait de l’exécution. L’autonomisation de la part idéelle du travail, celle qui se forme en esprit et préexiste à sa traduction matérielle, est ce qui lui confère une valeur supérieure : celui qui conçoit est par définition celui qui décide, celui qui peut revendiquer l’autorité, au sens propre et figuré, quitte à faire faire le travail par un autre. C’est bien le sens de la décision du tribunal judiciaire de Paris à l’endroit de Daniel Druet : ce sont les directives précises de mise en scène de Maurizio Cattelan qui ont fait de l’œuvre ce qu’elle est. Or ce principe vaut dans la plupart des organisations et fonde encore la distinction entre l’ingénieur et le mécanicien, l’architecte et le charpentier, le designer et le couturier, le scientifique et le technicien de laboratoire.
S’il est intéressant de se pencher sur la part intellectuelle du travail dans l’activité productive, c’est parce qu’elle est au cœur de la division sociale du travail et qu’elle y constitue un nœud de tensions. Comme le souligne l’historienne Dinah Ribard en ouverture de ce dossier, l’histoire du travail intellectuel ne se résume ni à l’histoire des professions intellectuelles ni à celle des manières dont on s’est représenté l’exercice de l’esprit. Si toute société a consacré en ses clercs ou ses scribes ceux dont la fonction sociale est de penser, le travail intellectuel représente une réalité bien plus large : il est l’espace dans lequel le travail fait l’objet d’une pensée, qui est à la fois l’exercice d’une liberté et un effort de formalisation. L’évolution de sa place dans l’organisation du travail en général est une clé de compréhension particulièrement féconde des transformations de cette organisation : alors que l’artisanat caractérise les activités où la pensée et le geste restent liés, la prolétarisation peut se définir comme le processus qui défait ce lien tandis qu’émergent des métiers dédiés à l’organisation et au contrôle du travail des autres.

La nomenclature statistique des professions et catégories socioprofessionnelles en France, formalisée par l’Insee en 1954, a traduit ce rapport à la part intellectuelle du travail dans la catégorie des « cadres et professions intellectuelles supérieures », rassemblant à la fois les métiers relatifs à l’organisation et à l’encadrement, et ceux de l’enseignement, de la recherche ou du droit – ceux, en somme, dont on considère qu’ils reposent sur l’exercice de la pensée. Mais que valent encore ces hiérarchies implicites dans des sociétés non seulement de plus en plus formées, mais où l’écrasante majorité des emplois relève d’un travail intellectuel7, en tout cas de la confrontation quotidienne à des réalités immatérielles ?
Les déboires de la professionnal managerial class
Dans un article paru en 1977, Barbara et John Ehrenreich ont forgé le terme de professionnal managerial class (PMC) pour désigner une nouvelle classe sociale qui, au sein du capitalisme, rassemblait des personnes en position de management, chargées de l’organisation de la production, sur un plan tant concret que symbolique – incluant ainsi les professeurs ou les journalistes8. Le propos enfonçait délibérément un coin dans la théorie marxiste orthodoxe, en faisant valoir que cette classe, parce qu’elle n’était ni prolétaire ni bourgeoise, représentait un sérieux obstacle à l’avènement du socialisme révolutionnaire, particulièrement aux États-Unis. En effet, les membres de la PMC, bien que ne possédant pas le capital, sont très éduqués et occupent des positions qui leur donnent une influence sur la société, influence dont le marxisme a eu tendance à penser qu’elle ne pouvait être le fait que des seuls « possédants ». L’âge d’or de la PMC fut aussi celui du rêve d’une classe moyenne composée d’experts pétris de rationalité, impliqués dans la modernisation de la société à travers le travail. Ses membres formèrent le gros des bataillons du Parti démocrate sous Bill Clinton ou du New Labour de Tony Blair, tandis que la working class s’en éloignait silencieusement.
Or, de l’avis même des auteurs qui l’avaient inventée, la professional managerial class s’est effondrée au début du xxie siècle9. Fragilisée de l’intérieur par des transformations technologiques massives, elle a vu son ambition d’encadrement de la société discréditée. La montée en puissance du numérique dans les processus de production, aujourd’hui amplifiée par l’intelligence artificielle, aura joué sur la PMC un rôle comparable à celui de la mécanisation industrielle sur les travailleurs manuels. En 2017, un article écrit par deux chercheurs de l’université d’Oxford fait grand bruit dans le monde du management et du conseil en stratégie, prédisant une disparition possible de 50 % des emplois aux États-Unis (54 % dans l’Union européenne) à un horizon de vingt ans, sous l’effet du numérique10. Contestée, discutée, adaptée à différents contextes, leur méthodologie a eu le mérite de faire prendre conscience de la fragilité de nombreuses entreprises face à cette « quatrième révolution industrielle ».
Dans le détail, elle a permis d’identifier, au sein de chaque métier, quelles étaient les tâches susceptibles d’être prochainement automatisables, pour en déduire un risque de disparition dudit métier : la traduction, le graphisme, mais aussi tous les métiers relevant de la gestion administrative et de la compilation de données se retrouvaient ainsi dans le viseur. La principale critique adressée à cette approche est que l’automatisation d’une tâche ne vaut pas nécessairement disparition du métier. En revanche, elle implique sa transformation et son recentrage sur les tâches non encore automatisables, dites « à forte valeur ajoutée ». Vu ainsi, c’est donc le milieu de l’échelle des qualifications qui s’est trouvé fragilisé par le numérique. Un ensemble de qualifications constitué de savoir-faire certes intellectuels, mais que l’on peut transformer en routines, et donc automatisables.
Pour imparfaite et discutable qu’elle soit, cette analyse éclaire de façon originale un double mouvement, que quiconque fréquente le monde de l’entreprise a pu observer : d’une part, la revalorisation un peu inattendue des métiers artisanaux, y compris au sein de populations très diplômées ; de l’autre, une surenchère dans l’injonction à la « créativité » chez les cadres supérieurs. Dans le premier cas – même si le discours et la réalité statistique de telles reconversions ne se recoupent pas complètement –, il s’agit de revendiquer à nouveau un lien entre la pensée et le geste, en tout cas une réappropriation des résultats de son travail, que la taylorisation des tâches intellectuelles a défaite dans de nombreux métiers qualifiés.
Dans le second, il s’agit de revendiquer encore la part noble du travail, celle de la conception, de l’intelligence injectée dans le faire, non substituable par la machine. On ne peut qu’être frappé, en lisant la littérature managériale ou en écoutant simplement le discours des cabinets de recrutement, par l’inflation de la référence au « talent », qui se met à désigner parfois les personnes elles-mêmes, et pas seulement leur qualité supposée : partout, il est urgent de recruter les « talents de demain », forcément rares. Étrange fortune de la parabole biblique qui invitait chacun à faire fructifier les dons reçus, où le « talent » devient ce qui justifie une position de supériorité dans l’échelle des qualifications et permet de revendiquer d’organiser le travail des autres.
La société civile qui pense
Ces évolutions ne sont évidemment pas sans conséquences sur les contours de la figure de l’intellectuel, telle que le xxe siècle l’a consacrée. Apparu en France sous la plume d’Émile Zola au moment de l’affaire Dreyfus, le terme a établi un lien consubstantiel entre l’exercice de la pensée et l’engagement dans l’espace public, au nom de la défense d’idéaux émancipateurs. La disparition de l’intellectuel est périodiquement annoncée depuis la fin du xxe siècle et, à bien des égards, le film Hannah Arendt (2012) de Margarethe von Trotta peut être regardé comme un éloge funèbre. Alors que le magazine américain The New Yorker commande à la philosophe un article sur le procès Eichmann qui s’ouvre en 1961 à Jérusalem, l’essentiel du film la montre, une fois revenue à New York, allongée sur son divan. Elle fume et regarde le plafond, tandis que prend forme dans sa tête le concept de banalité du mal. Elle discute avec ses amis, se fâche avec certains en leur exposant sa thèse, mais l’exercice de la pensée impose sa propre temporalité. Elle rendra l’article avec des mois de retard, et dans un format excédant largement celui de la commande, mais peu importe. Le travail intellectuel est ici magnifié sous deux aspects : sa souveraineté – Arendt ne rend de comptes à personne – et la puissance de ses effets – son texte oriente de façon décisive la compréhension du phénomène totalitaire.
Le caractère largement fantasmé de cette représentation, en particulier dans les pratiques de travail, disait sans doute en creux que cette figure de l’intellectuel ne correspond plus aux réalités contemporaines. Pas tant du fait que les personnalités susceptibles de l’incarner auraient disparu que parce que leur façon d’intervenir dans l’espace public s’est transformée. Dans un entretien intitulé « La fin des intellectuels ? », Jacques Julliard et Michel Winock mettaient ainsi le doigt sur un paradoxe : la disparition des grandes figures intellectuelles du xxe siècle est allée de pair avec une « banalisation de l’attitude intellectuelle dans le débat public11 ». En témoigne, jusqu’à aujourd’hui, l’inflation de tribunes et autres pages « idées » dans la presse, où des personnalités diverses (chercheurs, professeurs, ingénieurs, responsables associatifs ou syndicaux) expriment un point de vue autorisé sur un sujet.
Mais cette démocratisation de la fonction intellectuelle, qui n’est plus la chasse gardée des écrivains et des philosophes, s’est accompagnée d’un changement de nature de leur intervention. Alors que l’intellectuel traditionnel opérait un transfert de compétence et de notoriété, depuis son œuvre propre (littéraire, philosophique) vers le domaine politique, les individus qui investissent l’espace public aujourd’hui le font au titre de leur compétence professionnelle. C’est leur prise de parole qui fait leur notoriété, et non l’inverse. Il y a donc eu, pour Michel Winock et Jacques Julliard, un mouvement de « professionnalisation » des intellectuels, qui sont aussi de plus en plus nombreux, compte tenu de l’élévation générale du niveau de formation.
La démocratisation de la fonction intellectuelle n’a pas permis, bien au contraire, de consolider un espace public ouvert à la raison dialogique.
Vingt-cinq ans plus tard, ces observations restent actuelles. On est tenté d’ajouter que la démocratisation de la fonction intellectuelle n’a pas permis, bien au contraire, de consolider un espace public ouvert à la raison dialogique, que cette démocratisation coexiste avec la désinformation, la mauvaise foi, le règne du commentaire permanent, et que la relativisation des faits comme des opinions participe de la fragilisation de toutes les autorités savantes. Mais faut-il regretter le temps où seule une poignée d’hommes étaient légitimes pour exprimer une parole publique ? On peut défendre au contraire une fonction civique du travail intellectuel, qui tente de donner sens à un devenir politique commun. Ce travail n’est pas réservé à quelques grandes figures ; il appartient à ce que l’on pourrait appeler la « société civile qui pense ».
C’est de cette ambition que voudrait participer le présent dossier12 en se penchant d’abord sur les transformations qui affectent le travail intellectuel, le renouvellement de ses formes, les différentes modalités de circulation des idées dont elles témoignent et les pratiques collectives de travail qui les sous-tendent. Mais il s’agit aussi de prendre la mesure des forces de contestation qui pèsent sur lui aujourd’hui, des ressorts nouveaux de l’anti-intellectualisme à l’accusation de militantisme de plus en plus fréquemment faite aux chercheurs en sciences sociales, tandis que certains pouvoirs autoritaires n’hésitent plus à attaquer, à visage découvert, les libertés de pensée et d’expression que l’on croyait acquises. Prendre au sérieux ces menaces, c’est aussi affirmer l’horizon d’une certaine éthique du travail de l’esprit pour aujourd’hui – inventif, engagé, responsable et collectif – qui est au cœur du désir de poursuivre l’aventure d’une revue d’idées indépendante.
Notes :
1. Voir Thomas Golsenne, « L’affaire Druet vs Cattelan : l’art est-il un travail ? » [en ligne], AOC, 15 juillet 2022.
2. Voir Emmanuelle Jardonnet, « La justice donne raison à Maurizio Cattelan contre Daniel Druet », Le Monde, 8 juillet 2022.
3. Leonard de Vinci, Traité de la peinture, éd. André Chastel, Paris, Calmann-Lévy, 2003, p. 57.
4. L’expression « chose mentale » est attribuée à Vinci, bien que le mot « chose » n’apparaisse pas dans le Traité de la peinture.
5. Alberto Giacometti cité par Jean-François Billeter, Bonnard, Giacometti, P., Paris, Allia, 2023, p. 29.
6. Claude Esteban, Par-delà les figures. Écrits sur l’art, 1964-2006, éd. Xavier Bruel et Paul-Henri Giraud, préface de Pierre Vilar, Strasbourg, L’Atelier contemporain, coll. « Essais sur l’art », 2024, p. 404.
7. Le secteur tertiaire emploie 77 % des personnes en emploi en France en 2022 selon l’Insee.
8. Barbara et John Ehrenreich, “The professional-managerial class”, Radical America, vol. 2, no 11, mars-avril 1977, p. 7-31.
9. Alex Press, “On the origins of the professional-managerial class: An interview with Barbara Ehrenreich” [en ligne], Dissent, 22 octobre 2019.
10. Carl Benedikt Frey et Michael A. Osborne, “The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?”, Technological Forecasting and Social Change, vol. 114, janvier 2017, p. 254-280.
11. Jacques Julliard et Michel Winock, « La fin des intellectuels ? », Esprit, mars-avril 2000.
12. Ce dossier a été coordonné avec Emmanuel Laurentin, la rédaction le remercie. Merci également à Rémi Baille pour son aide.





Comments