La fabrique du rêve
- NAJIB BENSBIA
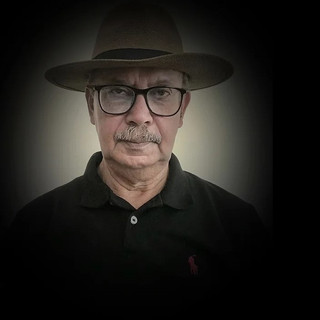
- 23 déc. 2024
- 4 min de lecture
Que saisir du rêve, cette grande machine de l’imaginaire humain, que comprendre de son mystère, ce langage sans mots, à travers les multiples formes qu’il a revêtues dans l’histoire de l’art ? C’est la question qui est soumise à examen dans le dernier ouvrage de Victor Stoichita « La fabrique du rêve ».

Par Pascal Dethurens I ESPRIT
Ouvrage érudit et somptueux à la fois, riche de plus de 150 illustrations, bien fait pour la contemplation et l’étude tout ensemble. On ne saurait assez s’étonner du risque qui est pris, à nouveau, par l’auteur de L’Instauration du tableau (1993), de la Brève histoire de l’ombre (1997) et de L’Image de l’autre (2014). Peindre le rêve suppose en effet, à l’en croire, que l’on sache entrer dans le rêve du rêveur, autrement dit que l’on parvienne à rendre visible ce qui est occulté, à dévoiler l’impénétrable. De l’art de lancer des paris audacieux.
Freud, dans Die Traumdeutung1, se proposait d’explorer la voie susceptible de conduire du contenu manifeste du rêve à son contenu caché, ancré dans l’inconscient. Plus précisément, soutient-il, le rêve pense, et il pense en images. Voilà qui ne pouvait laisser indifférents les spécialistes de l’image, les peintres au premier chef : si les songeurs provoquent les onirologues, les peintres, à leur tour, mettent au défi les interprètes. Mais quels songes ? Macrobe, au IVᵉ, siècle de notre ère, en a dressé une typologie, dans laquelle il distingue le songe énigmatique (somnium) qui signifie sous un voile d’obscurité, la vision (visio) qui dévoile l’avenir, l’oracle (oraculum) qui manifeste une révélation d’origine divine, les songes diaboliques et tentateurs (insomnia) engendrés par les soucis du jour, et les apparitions effroyables (visa). On voit l’étendue des représentations possibles qui s’offrent aux peintres, et c’est le grand mérite de Victor Stoichita de convoquer ceux d’entre eux, de Bosch à Dürer, de Corrège à Giorgione, mais encore de Goya à Michel-Ange ou de Signorelli à Vermeer, qui ont fait du rêve la matière même de la création.
Les récits de rêves abondent au Moyen Âge, à la Renaissance et à l’âge classique. L’essai se propose d’en étudier les formes et leurs métamorphoses dans le cours de l’histoire, mettant à l’épreuve les capacités interprétatives des spectateurs. Le problème herméneutique est de taille : comment approcher l’indistinct et lui donner un sens ? Aussitôt viennent à l’esprit les œuvres archétypales, longuement commentées par le critique, le Songe de Michel-Ange, le Cauchemar de Füssli, les Caprices de Goya, le Songe du chevalier de Raphaël, l’Apparition nocturne de Jordaens. Partout l’image montre ce que personne, le rêveur excepté, n’a vu : le tableau se change, non plus en miroir du monde, mais en écran du fantasme.
D’exceptionnels moments d’analyse se succèdent dans ce livre savant. Le chapitre sur les « oreillers de Dürer », suivant son titre, met en évidence le rapport trouble qui s’instaure entre le rêveur et le spectateur. Le diable qui manipule un soufflet près de l’oreille du dormeur, dans le Songe du docteur, nous fixe d’un œil écarquillé, manière de dire, à qui sait lire l’image, que si le dormeur est stimulé par l’oreille, le spectateur l’est, lui, par le regard. Serions-nous sans le savoir des rêveurs éveillés ? L’art de Dürer pose des questions plus qu’il n’y répond.
D’une science éblouissante, Victor Stoichita propose une lecture originale et convaincante d’œuvres que leur célébrité rend, malgré elles, inapprochables. Les Visions de l’au-delà de Bosch sont de celles-là, à le suivre, tant elles sont l’expression de songes et de cauchemars singuliers. L’univers onirique du peintre flamand rattache les hallucinations à une origine diabolique, origine étrangement créatrice de formes de toutes sortes, en cela proche du pouvoir créateur du peintre lui-même. À Dieu qui a tout créé, le peintre substitue, le rêve aidant, le rêve qui recrée tout. Nul hasard si, comme dans le Saint Antoine de Schongauer, c’est le diable, l’éternel rival, qui mène le rêve.
Mais le livre va plus loin, en particulier dans les analyses qu’il consacre aux rêves initiatiques et aux rêves prophétiques. Parmi les premiers, une place de choix est faite au Songe de Poliphile de Francesco Colonna, cet extraordinaire roman illustré écrit en un mélange inédit d’italien, de grec et de latin. Dans cette œuvre, le rêve commence, comme au début de la Divine comédie de Dante, au milieu d’une forêt obscure, propice au sommeil et au songe, et tout le récit, allégorique, se présente à la façon d’un voyage initiatique amoureux effectué en rêve. Parmi les derniers, Victor Stoichita se penche longuement sur le Songe de Constantin de Piero della Francesca, modèle de référence du rêveur inspiré par Dieu. Ce n’est pas seulement l’activité psychique nocturne qui est mue par le rêve, c’est l’Histoire humaine tout entière. Le temps viendra, bientôt, où Calderon donnera pour titre à sa pièce la plus fameuse La Vie est un songe.
La vie est un songe, semblerait-il, à lire La Fabrique du rêve. De partout, est-il rappelé, le songe gouverne les activités des hommes. « Nous veillons dormans, et veillans dormons », écrit Montaigne dans les Essais. La vie n’est donc qu’un rêve, bel et bien, un long rêve dont nul ne s’éveille tout à fait, et peut-être vaut-il mieux qu’il en soit ainsi. « Puisque la vie est si courte », comme le fait savoir Sigismond, « rêvons, ô mon âme, rêvons de nouveau, mais en prenant bien soin de ne point oublier qu’il nous faudra un jour nous réveiller au beau milieu de ce rêve doré ».
Cet artticle a été initialement publié sur le site ESPRIT sous le titre «La Fabrique du rêve. Songe et représentation au seuil de la modernité de Victor Stoichita ».
----
1 - Traduit et publié en français L’interprétation du rêve, (Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige », rééd. 2012).





Comments